Le socialisme et le mouvement social au XIXe siècle
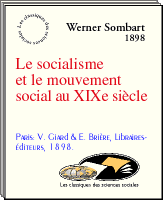
|
Titre: |
Le socialisme et le mouvement social au XIXe siècle | ||
|
Auteur: |
Werner Sombart | ||
|
Editeur: |
Edition numérique : www.uqac.ca Originale: V. Giard et E. Brière, libraires-éditeurs (Paris) |
Dates de parutions: |
2004 1898 |
Rattaché avec Max Weber à l'Ecole historique allemande, le sociologue Werner Sombart croit au progrès et interprète l'histoire dans une stricte linéarité ascendante, caractérisée par la prise de pouvoir par des catégories sociales, qui imposent leurs formes successives aux sociétés. Ainsi, il écrira une genèse convaincante du capitalisme (mot dont il serait l'inventeur, si l'on en croit l'article de Wikipedia qui lui est consacré) avec Le bourgeois en 1928. Cependant, le présent ouvrage qui rassemble des conférences données en 1886 à Zurich se place, pour une part au moins dans la prospective, avec les erreurs et approximations qu'il est aisé pour nous de constater aujourd'hui…
En accord avec Marx, donc, Werner Sombart confond l'histoire de toute société avec l'histoire des luttes de classes. C'est l'avènement nécessaire du capitalisme qui fera naître une nouvelle classe, le prolétariat, en organisant toute production selon l'association du capital et du travail. Cette nécessité est encore renforcée par le progrès technique, qui exige une production quantitative et une concentration des moyens toujours supérieures. Ce prolétariat se caractérise par un déracinement complet et une dépendance totale vis-à-vis de ses nouveaux maîtres bourgeois (« ceux qui disposent de toute cette splendeur, ce n'est plus l'Eglise, ce ne sont plus des princes, mais ceux dont les masses sentent qu'elles dépendent, ceux dont la puissance économique les détient directement, ceux dans lesquels elles voient leurs exploiteurs »). Cette précarité, renforcée par un monde de la compétition généralisée dans lequel « la belle quiétude contemplative a disparu », avec une inégalité matérielle flagrante vont induire des communautés naturellement communistes, dont la psychologie sera mue par les passions révolutionnaires collectives, la haine, la jalousie, la révolte.
Face à l'économie politique classique, couronnée à l'époque par Adam Smith et David Ricardo, apparaît une littérature anticapitaliste qui prétend fonder théoriquement des principes nouveaux et un autre idéal. Dans cette dernière, Sombart distingue un courant réactionnaire d'une part, qui combat l'ordre bourgeois libéral en prônant un retour aux règles anciennes, corporatives et féodales, et d'autre part, un courant qui assimile l'idéologie des Lumières et l'évolution capitaliste moderne, tout en souhaitant amender le système dans l'intérêt du prolétariat. Bien sûr, au nom du progrès, seul ce dernier courant a les faveurs de l'auteur et mérite la qualification de « socialiste ». Dans les premiers socialistes « utopistes » (Saint-Simon, Fourier…), il distingue l'anglais Robert Owen : croyant en la bonté naturelle de l'homme, ce dernier s'oppose aux classiques en ce qu'il ne croit pas « l'ordre naturel » réalisé mais pense qu'il est à chercher dans des rapports plus justes entre les hommes, où l'économie privée et la production individuelle feront place à une production en commun, fondée sur l'association. Au niveau tactique, c'est la croyance au progrès et aux lumières qui doit faire souhaiter à tous les hommes suffisamment éclairés la réalisation de cette organisation idéale. Ainsi, les utopistes veulent ignorer l'intérêt qu'une classe trouve dans le maintien du système actuel, tout comme sa possession de la force pour cela…
Dans la genèse du mouvement social prolétarien, Sombart exclut les différentes révolutions françaises (1789, 1793, 1830, 1832, 1848), qui ne sont jamais que des mouvements bourgeois, comme en témoignent leurs réalisations : de la loi martiale du 20 octobre 1789 sur les émeutes à la déclaration dans la Constitution de 1793 comme droits de l'Homme de l'Egalité, la Liberté, la Sûreté et la Propriété, en passant par la loi Le Chapelier sur les coalitions et l'institution du suffrage censitaire (cf. Un homme, un vote ?) en 1791. Même la conspiration dite communiste de Babeuf en 1796 était sans attache avec les masses. Les premières révoltes ouvrières anglaises de la fin du XVIIIe et du début XIXe sont rejetées dans la « préhistoire du mouvement social » en raison de leurs revendications réactionnaires pour retrouver les privilèges perdus. Idem pour le mouvement chartiste de 1837-48 qui, plus authentiquement prolétarien dans sa constitution, ses motivations (le capital identifié comme ennemi) et ses moyens d'action (recours à la grève générale), ne l'est pas dans ses buts poursuivis, la Charte n'étant qu'un ensemble de réformes parlementaires qui ne l'écarte pas vraiment de la démocratie bourgeoise, comme le ferait un programme réellement socialiste. Passés ces événements, le mouvement ouvrier anglais se caractérisera par son aspect exclusivement économique et syndical, et non politique comme en France (révolutionnarisme) ou en Allemagne (parlementaire et légalitaire). Face à cela, Sombart se pose la question de la forme essentielle du mouvement social. Il y répond en mettant en avant les particularités nationales déterminantes.
Ainsi, après 1850 et la disparition de tout mouvement social révolutionnaire, le mouvement ouvrier britannique est resté strictement apolitique et a obtenu, en restant dans le cadre de l'organisation économique capitaliste, l'amélioration du sort d'une grande part des ouvriers en fondant des caisses de secours, des coopératives et des syndicats. Cela s'explique en grande partie par le formidable essor du capitalisme anglais et sa situation de monopole industriel. Dans ce contexte, les patrons n'ont jamais vu d'un mauvais œil ce mouvement ouvrier qui, finalement, servait leurs intérêts : en situation de plein-emploi, les trade-unions garantissaient la paix sociale, les surcoûts du travail étaient compensés par un haut niveau de production auquel les débouchés ne manquaient pas, et favorisaient la concentration en éliminant les petits entrepreneurs. Cette concordance matérialiste des aspirations sociales et libérales préfigure le devenir ultérieur des sociétés capitalistes où, comme disait déjà Péguy au début du XXe siècle : « aujourd'hui, nous sommes tous des bourgeois ». Mais, n'anticipons pas et revenons-en à Werner Sombart… Celui-ci estime que le mouvement anglais lèguera au prolétariat sa parfaite organisation syndicale. Face au caractère froid et pragmatique des Anglais, le mouvement français se distingue par une surexcitation, une propension convulsive à l'émeute et à l'entretien de querelles de clochers qui interdit tout mouvement d'ampleur réellement sociale. Cela tient à la forte empreinte de l'individualisme petit-bourgeois sur tout mouvement prolétaire français, qui ne cesse de vivre dans le souvenir nostalgique de sa grande Révolution. Ainsi ce mouvement donnera naissance à l'anarchisme (Blanqui), « forme nouvelle du révolutionnarisme comme méthode et de l'idéal petit-bourgeois comme but ». Au contraire, en Allemagne, le trait caractéristique est le divorce complet entre la masse populaire et la bourgeoisie libérale qui nourrira toujours une crainte du spectre rouge. En instituant le suffrage universel et secret en 1867 (par « haine diabolique du libéralisme », avance Sombart…), Bismarck affaiblira définitivement (ou au moins jusqu'à ce qu'on impose le progrès à l'Allemagne par la « Guerre du Droit », cf. Le siècle de 1914) une bourgeoisie désormais coincée entre le parti des Junkers et le parti ouvrier. Ce dernier parti, fortement marqué par la personnalité de son instigateur, Ferdinand Lassalle, restera exclusivement cantonné dans une voie parlementaire. Puis vient le « messie » qui dépassera les particularités nationales pour universaliser le mouvement prolétaire : je veux parler, bien sûr, de Karl Marx.
Werner Sombart ne peut évidemment qu'approuver la vision marxiste de l'histoire exclusivement déterminée par les rapports économiques, la formation des classes et les rapports de domination qui en découlent. Ainsi, si la bourgeoisie a libéré des forces productives immenses qui la dépassent aujourd'hui en poussant inexorablement à la socialisation du processus de production, l'apport essentiel de Marx est d'avoir unifié et internationalisé le mouvement du prolétariat en posant la société communiste comme but et la lutte des classes comme moyen. La nécessité de ces deux piliers se déduit du développement historique. Certes, Sombart critique le recours à la dialectique hégélienne, jugée périmée, pour démontrer la nécessité de ce mouvement mais reprend la démonstration avec ses arguments psychologiques du devenir social. Une classe tend naturellement à s'émanciper, c'est-à-dire pour le prolétariat, à se libérer de sa soumission au pouvoir économique du capital. Pour ce faire, s'il ne choisit de détruire le capitalisme dans une voie régressive (ce qui est évidemment exclu si l'on prépare correctement le prolétariat), il lui faut le dépasser en conservant les formes existantes de la grande production. Cet idéal découlant du sens de l'histoire et les intérêts égoïstes menant le monde, l'excitation des passions les plus basses dans la classe prolétarienne est parfaitement justifiée : sans être un adepte de « l'homme naturellement bon », force est de constater qu'on est là, très éloigné de toute politique fondée sur une conception de l'homme un tant soit peu supérieur à la bête ! La « lutte des classes » est également dédramatisée puisqu'elle est la règle de la vie même… Sombart ne voit pas pourquoi la société sans classes se confondrait avec la fin de l'histoire : le processus doit continuer (pour descendre toujours plus bas ?) ! Il est vrai que, plus policé, il conteste tout révolutionnarisme (volontarisme précipité, comme en 1848) et ne conçoit la lutte que parée de la vertu du bon droit, « fair-play » et accompagnant l'évolution dans son sens inéluctable. L'avènement de la société nouvelle devant impliquer totalement les masses, il décrète même que « l'époque des coups de main, des révolutions faites par de petites minorités entraînant des masses inconscientes » est passée. Lénine en prendra le plus parfait contre-pied et ce, dans un pays parmi les moins industrialisés…
Pourtant, Sombart a cru voir une confirmation de ses projections, dans l'histoire de la deuxième moitié du XIXe siècle… Passé l'échec de 1848, parallèlement à l'internationalisation du capitalisme, le prolétariat a semblé tendre vers une certaine unification. Marx, revenu à une conception de la révolution comme stade ultime de l'évolution, exclut les déviants comme Bakounine ou les anarchistes. Par une prolétarisation accrue, imputable à l'augmentation de la concentration et la disparition de la petite industrie, le développement du capitalisme gonfle les rangs marxistes, représentant « toute la classe ouvrière consciente et organisée ». Une fois acquise cette marche engagée vers l'unification substantielle du mouvement, Sombart nous présente quelques questions en suspend sur de menus antagonismes secondaires… Ainsi en est-il de l'opposition entre révolution et évolution, rapidement tranchée : le révolutionnarisme, bien que récurrent, traduit un manque de maturité et l'évolution sociale bien comprise consistera en une conquête progressive du pouvoir en vue d'une organisation nouvelle de la société, commandée par la transformation des rapports économiques. Mais, attention ! Cela ne nous autorise pas à sombrer dans le quiétisme : si les responsables du progrès ne font rien et attendent, l'évolution peut tout aussi bien conduire à la destruction de la civilisation moderne (voilà qui serait ennuyeux…) ! Plus pertinente à mon sens, la mise en garde contre la confusion entre programme et idéal pour ceux qui sont englués dans la politique des démocraties libérales. Un grand classique ! Ou, en voulant jouer dans un système qui n'est pas le nôtre, à force de compromissions, si l'on n'agit pas comme on pense, on finit par penser comme on agit… Autre problème : démocratie ou socialisme ? La condition de prolétaire étant le terreau exclusif du progrès social, que faire des masses qui ne sont pas encore tombées dans le prolétariat, petits bourgeois et paysans notamment ? Sombart préconise à la démocratie socialiste de ne pas pactiser avec les classes « notoirement décadentes » (artisans et petite industrie) et ne statue pas sur l'agriculture, tout en concédant simplement que les considérations de Marx ne s'y appliquent pas. Quel manque d'imagination ! Les soviétiques, eux, apporteront une réponse…
Enfin, il pose la question de l'attitude du mouvement social vis-à-vis de la Religion et du Nationalisme. L'opposition à la religion aurait deux causes purement accidentelles… L'une théorique tient à l'héritage assumé des « lumières », et l'engouement pour l'athéisme et le matérialisme ne serait qu'une expression de la contestation des dogmes en place. Curieux : il n'y a plus aucun mot à cet endroit sur le déracinement des prolétaires… La deuxième raison serait plus pratique et tiendrait à la position toujours proche du pouvoir en place, tenue par le « christianisme officiel » (il ne parle pas que de l'Eglise catholique car, ne l'oublions pas, il est allemand). A condition d'expurger tout caractère ascétique qui ne peut satisfaire une classe foncièrement hédoniste, le christianisme pourrait aussi bien s'adapter à la nouvelle société… A propos de l'appartenance nationale du mouvement social, Sombart affirme que le patriotisme, dans sa notion romantique et incarnée, ne pourra jamais disparaître du cœur des masses. Un peu plus compliqué pour le nationalisme : par pragmatisme, le prolétariat ne devra pas l'assimiler éternellement aux actuelles classes dirigeantes honnies. Car en face d'une pression extérieure qui peut menacer nos intérêts (la « barbarie russe, suivie de près par la barbarie de l'Extrême-Orient »), il faudra savoir mettre en veilleuse les antagonismes sociaux au profit d'une cohésion nationale. Ca, c'est l'outil magique dont les démocraties bourgeoises ont admirablement joué en 1914 ! Sombart y voit aussi la raison de l'écroulement de tout internationalisme prolétaire aux Etats-Unis face au développement asiatique (Chine et Japon, déjà). De même, « il arriverait à son terme dans le prolétariat occidental au moment où les coolies commenceraient à l'assaillir comme des rats ». Cette question du nationalisme est au centre du livre La Gauche réactionnaire (sur une gauche certes pas marxiste mais plutôt blanquiste), qui consacre également tout un chapitre sur l'impasse théorique de l'athéisme matérialiste.
Enfin, l'histoire s'est chargée de conclure : cette étude lui appartient définitivement puisque, finalement, c'est le libéralisme bourgeois qui a triomphé ! Reste pour nous d'en tirer les leçons pour bâtir une opposition qui ne participera pas des principes propres de ce dernier…
Georges
Bibliographie :
-La version numérique de l'ouvrage est téléchargeable ici.
-Werner Sombart, Le bourgeois, Contribution a l'histoire morale et intellectuelle de l'homme économique moderne (1928), Payot, 1966
- Marc Crapez, La Gauche Réactionnaire. Mythes de la Plèbe et de la Race, Berg International, 1996
- Marie-Madeleine Martin, Les doctrines sociales en France et l'évolution de la société française du XVIIIème siècle à nos jours, Editions du Conquistador, 1963
-Aux sources de l'erreur libérale
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 92 autres membres

