Survivre au développement
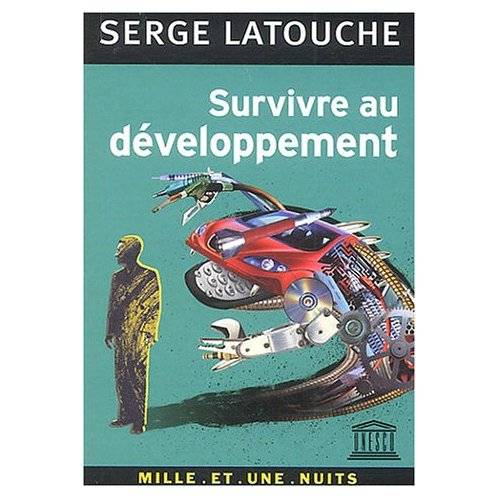
|
Titre: |
Survivre au développement De la décolonisation de l’imaginaire économique à la construction d’une société alternative | ||
|
Auteur: |
Serge Latouche | ||
|
Editeur: |
Mille et une nuits |
Date de parution: |
Octobre 2004 |
Bien qu’enseignant l’économie à l’université, l’auteur se distingue par des positions plus que critiques vis-à-vis de la doxa économiste. Et c’est heureux ! Dans cette étude réalisée à la demande de l’UNESCO, suite au symposium « défaire le développement, refaire le monde » de 2004, il s’attaque donc au pilier économiste de la fuite en avant indiscutable du développement et de la croissance.
Le mythe du développement apparaît après la deuxième Guerre Mondiale, avec le discours de Truman en 1949, qui divise la planète en pays développés et sous-développés (ou « en voie de développement » pour être politiquement correct, mais cette expression souligne encore plus la nécessité incontournable, propre à l’hypothèse développementiste !). Grands princes, les ricains seront prêts à venir en aide à ces pays pour qu’ils se hissent à leur niveau : ce sera surtout le prétexte pour piller les réserves naturelles dont eux, en premier, ont besoin, mais au nom de l’œuvre bienfaitrice d’apporter le progrès à ces pays, sortis de l’orbite des européens par la décolonisation ! Pour résumer cette idéologie, toute la diversité culturelle des pays du sud est réduite à une seule catégorie (les pays sous-développés), et la seule échelle universelle de valeur est la norme matérialiste de la production industrielle (pensez aux classements des pays selon les seuls critères quantitatifs tels que le PIB, etc. Même pour rendre compte du « progrès » culturel, les indicateurs retenus sont : l’accès à la technologie Internet, le nombre de téléviseurs rapporté à la population, et que sais-je encore !)…
Au final, le mondialisme n’est que l’aboutissement de l’hégémonie de cette idéologie matérialiste et mortifère, et de l’occidentalisation du monde, commencées toutes deux avec le colonialisme. En imposant le système, originellement européen, de concentration capitalistique, de déréglementation, décloisonnement, désintermédiation, et finalement de dictature des seuls marchés financiers souverains, le développement est fondamentalement un déracinement et a détruit toutes les formes de sociabilité, jusqu’aux ultimes barrières des régulations étatiques, au nom de la prétention épistémologique de la « science économique » à être naturelle et universelle, se cachant ainsi son réel postulat idéologique de base (voir l’invention de l’économie, dans la bibliographie, ou encore Max Weber, Werner Sombart)… Loin d’avoir réduit l’écart entre la pauvreté des « sous-développés » et la richesse du modèle, il l’a accru et, de toute façon, la réalisation de cette idéologie est une utopie des moins souhaitables : si tous les pays avaient le mode et le niveau de consommation des Etats-Unis, on aurait déjà épuisé les réserves planétaires, notamment en pétrole, sans parler de l’aggravation des conséquences écologiques ! L’auteur multiplie les exemples concrets pour montrer que les concepts ethnocentristes de développement et de progrès étaient loin d’aller de soi, ou même d’être acceptables dans de nombreuses cultures différentes (en Afrique, en Amérique Latine, ou en Inde…). Les bonnes intentions qui ont conduit à imposer universellement ce modèle, s’appuient sur la croyance du « trickle down effect », ou « effet de retombées » de la croissance. Si ce mythe se justifie par l’exemple occidental des Trente Glorieuses, il s’avère parfaitement illusoire pour les pays du sud. Son application généralisée repose sur trois paradoxes principaux, liés à la création de besoins, à l’accumulation capitalistique, et au cout écologique de la croissance. La création de besoins artificiels (notamment par la publicité), nécessaire pour une consommation de masse et une incitation au travail, moteurs de la croissance, ne réduit pas la pauvreté dans les faits mais, au contraire, y ajoute une misère psychologique de frustration. De plus, le système combat les freins au développement que sont les solidarités communautaires qui existaient traditionnellement pour lutter contre la pauvreté par une redistribution gratuite. Pour augmenter la croissance et obtenir ses retombées sur tous, il faut favoriser l’investissement et pour ca, nous dit la théorie, augmenter dans un premier temps l’écart entre les riches et les pauvres, les premiers épargnant davantage. Malheureusement, si on a bien réussi à paupériser encore les plus pauvres, force est de constater que la faible incitation à investir tient plus à des facteurs psychoculturels qu’au manque d’épargne. Enfin, il est inutile de s’attarder sur le paradoxe écologique d’une croissance obsédée par l’évaluation de sa richesse numéraire, mais réalisée en pillant les richesses naturelles non renouvelables de notre planète : c’est assez évident et suffisamment répété. Bref, voila comment se présente le développement réel, et non tel qu’on peut le rêver : guerre économique avec son cortège de laissés pour compte, pillage sans retenue de la nature, occidentalisation du monde et uniformisation planétaire et enfin, ethnocide pour toutes les cultures différentes.
Il faut garder présent à l’esprit cette réalité pour ne pas faire fausse route si on veut la combattre, pas comme bon nombre d’antimondialistes qui rêvent un « autre mondialisme » qui ne serait que le retour au développement des années 60, éventuellement corrigé de ses effets négatifs, sans se rendre compte que cela reviendrait à reproduire le même mécanisme, doté de sa dynamique propre (les mêmes causes produisent les mêmes effets, quelles que soient les corrections accidentelles…). Mais, c’est évident, on ne se libère pas facilement de l’emprise de cet imaginaire économiste ! C’en est d’autant plus facile de se laisser prendre au piège sémantique de tous les « développements à particule » : développement social, humain, local, durable, alternatif… Tous ces oxymores (juxtaposition de deux mots contradictoires, comme le « clair obscur ») n’ont pour but que d’essayer de revitaliser cette idée de développement qui a déjà, partout, montré son échec. Ainsi, le développement social, qui veut corriger les conséquences sociales du développement sans toucher à son credo libre-échangiste, est une double hérésie : c’est un pléonasme au niveau de la théorie puisque les « effets de retombées » de la croissance doivent pleuvoir à terme sur l’ensemble du corps social, alors qu’au niveau vécu, du développement réellement existant, c’est, comme on l’a vu, un oxymore ! L’Indice de Développement Humain cherche à évaluer le progrès dans les domaines plus socioculturels qu’économiques : en pratique, il n’échappe pas à l’ethnocentrisme en quantifiant la satisfaction de besoins réputés universels, mais qui sortent tous du modèle de consommation occidental. Quant au développement local, voilà encore un bel oxymore ! Quand on sait que le développement mondial évolue vers une globalisation toujours plus apatride et a-spatiale, on comprend que, localement, le développement se traduira toujours, non par la revitalisation du tissu local, mais par l’installation temporaire d’un projet hétérodirigé, révocable à tout moment si une autre région propose des avantages comparatifs en matière de fiscalité, de déréglementation ou de subventions… Mais voici le meilleur piège sémantique pour gogos, jouissant actuellement du plus large succès, j’ai nommé : le développement durable ! Expression tellement vague et vide de sens, que tout le monde peut s’en réclamer et promettre, rassuré, le développement pour l’éternité : des ONG humanistes aux patrons de multinationales, en passant par certains altermondialistes ! Plus consensuel, faut trouver ! Sauf que, pendant que tout ce beau monde débat sur ce concept « auberge espagnole »(1), la vraie pratique du développement, elle, continue son bonhomme de chemin… Voilà un bel os à ronger pour d’éventuels opposants au sacro-saint développement ! Qu’il est risible de voir tous nos petits businessmen en herbe se précipiter avec une tellement bonne conscience dans les filières « développement durable » de leurs écoles de commerce ! Même les multinationales pétrolières ont toutes leur département « développement durable »… Or, je vous le demande : qu’y a-t-il de moins « durable » que de pomper les réserves fossiles comptées de notre planète, dont l’épuisement définitif est annoncé à une échéance relativement proche ? Mais nos sociétés ne sont pas à un comportement schizophrénique près…
Le cas du développement alternatif est plus problématique… Ou alors il désigne un « autre développement » qui participe de l’idéologie developpementiste, et c’est voué à l’échec, comme le courant de modernisation des campagnes françaises, piloté essentiellement par des ONG chrétiennes entre 1945 et 1980, et qui n’a abouti à long terme qu’à l’industrialisation des campagnes, avec son cortège d’exode rurale accrue, de surproduction au détriment de la qualité et de terrible misère des paysans écrasés par le surendettement. Ou alors, il s’agit d’un rejet de l’hypothèse developpementiste par des propositions véritablement alternatives, et dans ce cas, c’est une erreur de l’appeler « développement » alternatif. Car en prenant le mot, on prend tout le concept véreux qui va avec ! La solution passe donc par une démystification des principes developpementistes, préalable nécessaire à toute victoire contre l’empire de la pensée unique et la marchandisation du monde. L’auteur préconise un retour à la notion qualitative et politique du « bien vivre », fondée sur une insertion harmonieuse de l’homme dans le cosmos, et parfaitement distincte du bien-être matériel destructeur de l’environnement et du lien social, fondé, lui, sur l’hubris. Imposé par l’histoire ou volontairement anticipé, ce retour adviendra nécessairement puisque notre processus économique actuel est entropique et la capacité de charge de la Terre est déjà dépassée par notre surcroissance. La décroissance conviviale passe donc par une redéfinition qualitative du bonheur (du bien commun) et du lien social, une remise en cause de la centralité du travail dans nos vies pour affirmer la primauté des relations sociales sur la production ou la consommation de produits jetables inutiles, voire nuisibles, une sage limitation de nos besoins matériels (« dans quelle mesure chacun de nous est-il prêt à résister, dans sa vie quotidienne, à la colonisation des besoins socialement fabriqués ? »), une prise en compte du nécessaire renouvellement des ressources pour les générations futures (comme Colbert qui, encore au XVIIème siècle, réglementait la coupe du bois et replantait des chênes pour faire, 300 ans plus tard, des mats de vaisseaux). Pour les pays du sud, aujourd’hui gagnés au mirage du développement malgré l’obstinée contradiction des faits, il est nécessaire qu’ils retrouvent des règles endogènes de leur « bien vivre » social. Tous ces buts sont fondamentalement politiques mais n’excluent pas pour autant l’échelon local, auquel il faut redonner autonomie et initiative pour réenchâsser l’économique dans le social. Dans sa présentation du localisme, l’auteur part de l’exemple des rejetés de la croissance agglutinés dans les bidonvilles du Tiers-Monde, et qui ont réinventé une forme de lien social avec son économie informelle. De là, il voudrait « décoloniser les mentalités », les « déséconomiciser » par l’exemple d’ilots autarciques de résistance, appelés à faire tache d’huile et à se diffuser. Avec ces niches de résistance, « c’est ainsi qu’à l’inverse de Pénélope on retisse de nuit le tissu social que la mondialisation et le développement détricotent de jour. » Très belle image, mais c’est justement là qu’on ne suit plus complètement l’enthousiasme de l’auteur… Car, aussi estimables et intéressantes que soient ces expériences de communautés plus ou moins autarciques, systèmes d’échanges locaux (SEL), mouvements associatifs, producteurs alternatifs ou néo-ruraux (etc.), ce ne sont toujours que des résistances, et qui ne peuvent subsister que tant qu’elles sont tolérées par la superstructure (c’est-à-dire tant qu’elles n’inquiètent pas réellement l’ordre établi). Quelque soit le sens dans lequel on retourne l’histoire, c’est toujours un travail de Pénélope, donc vain en regard de la réalisation de la finalité (à moins que l’on revienne à la finalité réelle qui est l’attente d’Ulysse !). Bref, même en comptant sur l’électrochoc de catastrophes du développement (Tchernobyl, vaches folles, couche d’ozone, lait mélaminé…) sur les consciences, on ne peut pas faire l’économie, pour voir les choses changer, d’une conversion du politique… Et encore, avec énormément de prudence ! Imaginez la réaction des instances mondialistes contre un pays qui dirait subitement : « Salut ! Je me retire du jeu ! »…
(1) : alors que Serge Latouche dénombre, en 1989, entre 37 et 60 acceptions différentes du terme selon les auteurs, j’avais demandé, plus récemment, à la responsable d’une filière « développement durable » nouvellement ouverte au sein d’une grande université parisienne d’économie, à l’issue de sa présentation du cursus, comment on pouvait définir le développement durable, qui me semblait déjà recouvrir tout et n’importe quoi. Je cite la réponse de mémoire : « Hou là ! Vaste débat ! (apparemment, la question saugrenue de vouloir définir ce dont on parlait depuis 2 heures surprenait…) Un groupe de recherche (voir ce groupe rechercher m’amuserait !) s’est penché sur cette définition : il est arrivé aujourd’hui à plus de 100 définitions différentes (je ne me souviens plus du chiffre exact, mais c’était au moins de cet ordre de grandeur), et les recherches se poursuivent… » Mais, axer une formation universitaire sur un concept qu’on ne peut pas définir ne pose, manifestement, aucun souci…
Georges
Bibliographie
- Du même auteur, L’invention de l’économie, Albin Michel, octobre 2005, sur la genèse moderne de l’imaginaire économique.
- Aux sources de l’erreur libérale
- Le numéro 18 du Choc du mois, avec son dossier : « Soyons écolo, c’est réac ! »
- La république des irresponsables, sur la quadrature du cercle, ou comment être libéral quand on se rend compte des méfaits de l’individualisme…
- Brève histoire de l’avenir, de Jacques Attali, qui incarne l’intégriste de l’idéologie développementiste, appelant de ses vœux ses plus insupportables extrapolations : déterritorialisation complète, exaltation du nomadisme de certaines élites, creusement des écarts de richesses et de modes de vie, abrutissement des pauvres par une consommation frénétique et standardisée, etc.
- Enfin, La dixième porte, pour voyager au cœur du système « développé »...
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 91 autres membres

